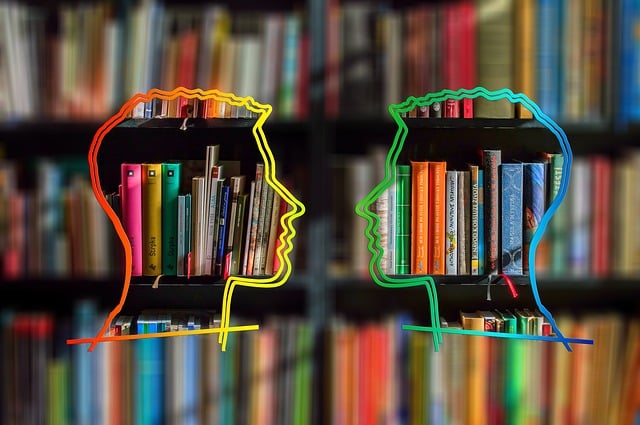
Première définition légale du handicap
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit la première définition légale du handicap.
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, article 2, titre Ier)
Cela a permis de modifier le Code de l’Action Sociale et des Familles, en y introduisant cette définition à l’article L.114.
Historique du terme
L'importance de la définition
« L’obscurité des lois rend le droit imprévisible » Phillipe Malaurie, L’intelligibilité des Lois (2005)
1975 : loi fondatrice
La loi d’orientation n°75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées est promulguée. Elle est la première loi posant les bases d’une politique du handicap et a ainsi permis de reconnaitre les personnes en situation de handicap comme des sujets de droits. En ce sens, elle a organisé leur prise en charge au sein de la société, en les éloignant d’une logique de prise en charge médicale et en s’appuyant sur les mouvements parentaux.
Et la définition ?
La loi d’orientation de 1975 n’a néanmoins pas défini la notion du handicap, laissant un flou quant à l’application notamment en ce qui concerne les évaluations menées au sein des différentes instances mises en place par décret à la suite de la loi.
Cela était le cas autant des Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMPS, décret n°76-389) que des Commissions Départementales d’Education Spéciale (CDES, décret n°77-1549) et des Commissions Techniques d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP, décret n°77-1548).
En effet, il manquait le référencement de méthodes d’évaluation de sorte à assurer la reproductibilité et la justesse des dépistages mais aussi des droits et des orientations données.
Pour cela, une définition claire du handicap aurait permis de mieux cadrer l’administration, notamment dans un contexte marqué par la saturation des demandes et le manque d’écoute vis-à-vis des envies des personnes.
La loi du 11 février 2005 et ses apports sémantiques

Elle fut ainsi la première loi à apporter une définition du handicap et à spécifier sa diversité en lien avec les troubles du neurodéveloppement, qu’il s’agisse du handicap mental, cognitif, psychique ou du polyhandicap.
Cet acte n’est pas seulement symbolique puisqu’en plus de diriger davantage l’application de la loi, il permet d’assurer auprès de ces catégories, l’effectivité de leurs droits fondamentaux.
Néanmoins, 20 ans après sa promulgation, nous constatons une application imprécise des orientations données par la loi de 2005.
La définition du handicap telle qu’elle est donnée dans cette loi reflète une avancée majeure, néanmoins, la formulation médicale, pourrait-elle constituer un obstacle quant à une application homogène ?
Le handicap est désormais admis comme une situation d’empêchement, variant selon la situation et les moyens de compensation donnés.
En mettant l’accent sur cet aspect, il ne s’agirait plus de définir une personne par son handicap en essayant de la greffer à un système rigide mais de définir le handicap, et les différents empêchements possibles au sein d’un contexte donné.
…Et ainsi de générer un modèle universel d’accessibilité ?